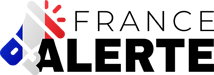Au fond d’eux, tous les policiers le savent. Un jour ou l’autre, dans leur carrière, ils feront face à une situation traumatisante. La recherche d’une petite fille de 12 ans, par exemple. Sitôt la disparition de Lola signalée, le vendredi 14 octobre en fin d’après-midi, des dizaines d’agents ont ratissé ce coin du 19e arrondissement de Paris à la recherche du moindre indice permettant de retrouver sa trace. Quelques heures plus tard, trois d’entre eux suivront un SDF qui a découvert le corps supplicié de la collégienne, enfermé dans une malle entreposée dans la cour d’un immeuble. Face à l’horreur, les réflexes professionnels, acquis durant leur formation à l’école de police, prennent le dessus : en attendant l’identité judiciaire, il faut préserver la scène de crime, prendre l’identité des témoins. Puis rédiger un rapport destiné aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs.Mais aucune préparation n’empêchera une telle intervention de laisser durablement des traces. « Avec le temps, on se renforce, on apprend à prendre du recul sur les choses. Mais quand on est sur des scènes de crime impressionnante, ça marque quand même », souligne Yvan Assioma, secrétaire régional Ile-de-France du syndicat Alliance. Comment les policiers pourraient-ils oublier les images de la victime, les cris de douleur de ses proches ? Comment ne pas être remué ?Mesures d’accompagnementDans la nuit, la hiérarchie des agents qui ont découvert le corps de Lola a appelé le numéro d’astreinte du service de soutien psychologique opérationnel de la police nationale (SSPO). Il propose aux policiers « des mesures d’accompagnement post-événementiel », c’est-à-dire « à la suite d’une mission ou d’une intervention sensible », explique sa cheffe, la psychologue clinicienne Catherine Pinson. « Dans un premier temps, ce qui est important, c’est d’identifier les personnels qui ont été mobilisés sur cet événement et de comprendre leur rôle, poursuit-elle. L’idée est de proposer des réponses adaptées et individualisées en fonction de la situation et de la place qu’ils ont eue. »Les policiers les plus choqués par cette mission ont ainsi pu s’entretenir individuellement avec un psychologue. Objectif de la séance ? « Faire le point et voir comment ils ont réagi, ce qui les a ramenés à des choses plus personnelles, répondre à leur questionnement sur leur métier, leur place. » Ceux qui le désirent pourront faire l’objet d’un suivi quelque temps. Les autres sont repartis avec pour consigne de rappeler le psychologue si le besoin s’en faisait ressentir.En 2021, le SSPO a réalisé 2.418 interventions de ce type, à la suite d’un événement. Environ 10.000 policiers ont été suivis cette année-là par l’un des 122 psychologues du service, répartis sur l’ensemble du territoire. Et en un an, les demandes de suivi individuel ont augmenté de 8 %. « Il n’y a plus de tabou » avec le fait d’aller consulter un psychologue, observe Yvan Assioma.« Il n’y a pas que des blessures physiques et visibles »Pendant longtemps, les policiers perturbés après une intervention compliquée devaient « se débrouiller seuls », se souvient le syndicaliste. « On buvait un café avec les collègues, on discutait entre nous. Si le chef de brigade voyait qu’il y avait un problème, il orientait l’agent vers le médecin. » En 1996, quelques mois après la vague d’attentats qui a frappé la France, est créé le SSPO, pour accompagner les policiers mobilisés à surmonter leur traumatisme. Une demande qui était portée par les syndicats de police. « A l’époque, les autorités ont pris conscience du fait qu’il n’y a pas que des blessures physiques et visibles. Il y a aussi des blessures invisibles, sur le plan psychologique », explique Catherine Pinson.Accidents de la route, attentats, découverte de cadavres, suicides, agressions… Après un événement extrêmement traumatisant peuvent se développer, chez certains policiers et gendarmes, des troubles du stress post-traumatique. « C’est une entité psychopathologique qui survient quand la personne a été confrontée, directement ou indirectement, à un événement qui a pu porter gravement atteinte à son intégrité physique ou psychologique », décrypte Mickaël Morlet-Rivelli, expert judiciaire en psychologie à la cour d’appel de Reims et doctorant en psychologie à l’université de Caen Normandie et au centre international de criminologie comparée de Montréal. Ces troubles se traduisent par l’apparition de signes, comme « une hypervigilance, des flash-back, des odeurs ou des images qui reviennent, des troubles du sommeil, du comportement alimentaire », poursuit-il.Une « blessure psychique » longue à soignerMickaël Morlet-Rivelli souligne qu’il existe désormais « des méthodes de traitement psychothérapeutique du trauma validées scientifiquement », comme « des thérapies cognitives ou comportementales ».De leurs côtés, les gendarmes ont aussi mis en place des dispositifs pour accompagner les militaires confrontés à un événement traumatisant. « Dans un premier temps, la hiérarchie, qui a été sensibilisée, se rend sur place. Ils échangent aussi longtemps que possible et de besoin avec leurs personnels pour assurer une forme de premiers secours psychologique. Ça fait partie des valeurs de la gendarmerie sur lesquelles on capitalise », explique le colonel Gwendal Durand, sous-directeur de l’accompagnement des personnels à la direction générale de la gendarmerie nationale. Les 85 psychologues, répartis dans tout le pays, prennent ensuite le relais et proposent aux gendarmes qui le souhaitent un entretien individuel.Ces professionnels de santé « décident de la durée de l’accompagnement ou de la thérapie qu’ils vont mettre en place avec le gendarme », poursuit l’officier. Et ce dernier de conclure : « Autant une blessure physique se répare assez vite, quelles que soient les conséquences. Ce qui est beaucoup plus long à soigner, qui est beaucoup plus lourd, c’est la blessure psychique. »SociétéMeurtre de Lola : Comment parler à ses enfants de la mort d’autres enfants ?Faits diversMeurtre de Lola : Dignité et émotion au rendez-vous pour dire adieu à la collégienne