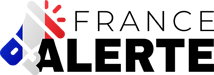Braqueurs, terroristes, preneurs d’otages… Depuis 60 ans, ils constituent le cœur de cible des hommes de la BRI, la brigade de recherche et d’intervention. Cette unité d’élite – la dernière de la PJ parisienne a être installée quai des Orfèvres – a été créée en 1964 par le commissaire François Le Mouël. Quatorze autres policiers lui ont succédé à la tête de celle qui a longtemps été appelée l’antigang. Son avant-dernier chef, Simon Riondet, a invité plusieurs de ses prédécesseurs à raconter leur expérience dans un livre passionnant qui sort ce jeudi aux éditions Mareuil*.
Parmi eux, René-Georges Querry. Il est arrivé en 1978 à la BRI « comme numéro 2 », explique-t-il à 20 Minutes. Quatre ans plus tard, le célèbre commissaire Robert Broussard le désigne pour prendre sa place. « C’est un service à part, avec des méthodes novatrices pour l’époque. Il a été imaginé pour faire face à la montée du banditisme juste après la guerre. Il y avait facilement cinq ou dix braquages chaque jour. Tout le monde rentrait dans les banques, l’argent était à portée de main, juste derrière les comptoirs. Il suffisait de braquer le guichetier ou les employés, les types ouvraient les coffres et vous partiez avec de l’argent liquide. C’était vraiment la source principale de financement du grand banditisme. »
« Un petit côté cow-boy »
Les policiers apprenaient souvent après coup l’identité des auteurs par leurs informateurs. Mais les preuves manquaient pour les interpeller. « Ils avaient déjà planqué l’argent », poursuit René-Georges Querry. Le commissaire Le Mouël a donc eu l’idée de faire les choses à l’envers. « Il fallait anticiper et surveiller les voyous susceptibles d’agir et les interpeller en flagrant délit. C’était novateur d’une part mais c’était surtout un exercice périlleux. Il y avait, qu’on le veuille ou non, un petit côté cow-boy. On avait à l’époque ce qu’il y avait de mieux comme matériel. » Les fonctionnaires devaient agir au bon moment. « Si vous intervenez trop tôt, il n’y a rien. Si vous intervenez trop tard, il n’y a plus rien », souligne l’ancien policier.
De son passage, il garde « évidemment » le souvenir de « l’arrestation de Mesrine ». Mais l’épisode qui l’a le plus marqué, c’est la mort d’un inspecteur de la BRI avec lequel il faisait équipe, lors d’une interpellation compliquée. « Il y a eu une maladresse, il a pris une balle d’un collègue d’un autre service. »
Il remarque qu’à la BRI, les chefs sont plus proches de leurs effectifs que dans d’autres services. « Après 48 heures de planque, les mecs ont tous la même gueule. Ils ne sont pas rasés, ils ont la tête de travers, les cheveux ébouriffés. L’été je sentais la sueur, l’hiver vous crevez de froid. C’est impossible de distinguer le commissaire d’un jeune inspecteur. On est tous dans le même pétrin. Quand vous rentrez dans un appartement pour neutraliser un cinglé, votre vie dépend de la réaction de vos inspecteurs qui sont à vos côtés. Et leur vie peut dépendre de votre propre réaction et de votre propre engagement. Tout ça gomme les grades. Dans un service comme la BRI, l’autorité ne s’impose pas, elle se mérite. »
« On était heureux que les gamins sortent »
Jean-Marc Bloch lui succède quelque temps plus tard, en 1989. Il est le chef qui est resté le plus longtemps à la tête de la BRI (sept ans). Mais l’ancien policier y est arrivé bien avant comme numéro 2, en 1981. « A l’époque, c’était le seul service qui disposait de “sous-marins”, qui effectuait des écoutes téléphoniques… Il y avait des moyens techniques dont tous les autres services de PJ étaient dépourvus. » Dans les années 1980, il a vu la cible de l’unité évoluer, les terroristes d’Action Directe remplaçant peu à peu les braqueurs de banques. « C’est compliqué le terrorisme, plus que le banditisme. Ce sont des mecs plus intelligents, plus malin, plus structurés, qui n’ont pas peur de mourir, pas peur de la police », remarque-t-il. « On n’avait pas de documentation sur eux, on ne savait pas qui on surveillait. On était à la remorque de la brigade criminelle, des Renseignements généraux, d’autres services. Quand on voyait un bandit dans la rue, on savait l’identifier nous-même, on connaissait ses relations. Avec les terroristes, à chaque fois, il fallait qu’on demande aux autres qui c’était. »
L’ancien commissaire a géré 31 prises d’otages, « c’est énorme ». Pour obtenir la reddition des preneurs d’otages ou des forcenés, il s’appuyait sur « des équipes super bien organisées, structurées ». « Et ensuite il faut parler. C’est la devise de la BRI : d’abord par le verbe, ensuite par les armes. Et c’est exactement ça. Les armes ne sont que l’ultime solution si on n’y arrive pas autrement. Il faut dire au mec : “regarde, on est nombreux, on est fort, on n’a pas peur, on sait faire, t’es coincé. Maintenant on va discuter, on va essayer de s’arranger. Mais si tu fais le con ça va mal se passer pour toi”. Il faut essayer de faire comprendre ça aux gens d’en face et ensuite la pression baisse et à un moment ça cède. » Parmi les interventions qui l’ont marquée, la prise d’otage de la maternelle de Neuilly en 1993. « On était heureux que les gamins sortent. »
« On sentait monter cette menace »
Autre période, autre priorité. Avant de commander la prestigieuse brigade criminelle , Michel Faury a dirigé les hommes et les femmes de la BRI entre 2013 et 2021. « Ce sont deux services qui sont au cœur de l’actualité quand une affaire est sensible », observe-t-il. Celui qui dirige aujourd’hui la SDAT (Sous-direction antiterroriste) a été l’un des premiers à constater, à l’époque, « une poussée de l’islamisme radical ». Il décide de transformer l’unité en restructurant et modernisant sa brigade anti commando. « Je disais toujours : entraînez-vous, un jour, vous pousserez un bouclier face à des gens qui vous tireront dessus à la kalachnikov. Et c’est exactement ce qui s’est passé quelques années plus tard. Dès qu’on avait du temps libre on s’entraînait, on sentait monter cette menace. »
Lorsqu’il était à la BRI, Michel Faury dit avoir été confronté à l’« ultraviolence ». Le commissaire se souvient notamment d’une intervention sur un braquage à Aubervilliers. « On est arrivé en plein milieu d’une fusillade, et ils ont tué de sang-froid le convoyeur », se souvient-il. « Sous mon commandement, on a eu aussi pas mal d’affaires où on a été amené à échanger des coups de feu avec des malfaiteurs ou des individus retranchés, des malades mentaux ou des schizophrènes », poursuit Michel Faury. Il se rappelle en particulier l’affaire des frères Lascar à Pantin. Les jumeaux, des mathématiciens renommés, s’étaient retranchés chez eux. « L’un d’eux nous avait tendu un piège, il voulait qu’on rentre chez lui où il nous attendait avec des armes. » Sur l’instant, il décide de ne pas donner l’assaut et préfère négocier avec eux. « Ça a été finalement un choix qui a peut-être sauvé des vies. »
Michel Faury a quitté la BRI en 2013, après y avoir passé cinq ans. « C’est un service marquant, je suis parti à contrecœur », reconnaît-il. « J’avais du mal à quitter les gens avec lesquels j’avais bossé, que j’aimais bien, que je connaissais… Il y a des liens d’amitié qui se créent. Et j’aimais ce métier, les gens qui le faisaient, cette activité très variée, vivante. C’est un peu pour ça qu’on rentre dans la police. »
* « BRI, les patrons de l’antigang se mettent à table », de Simon Riondet, Mareuil éditions, 21 euros