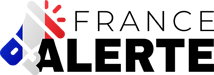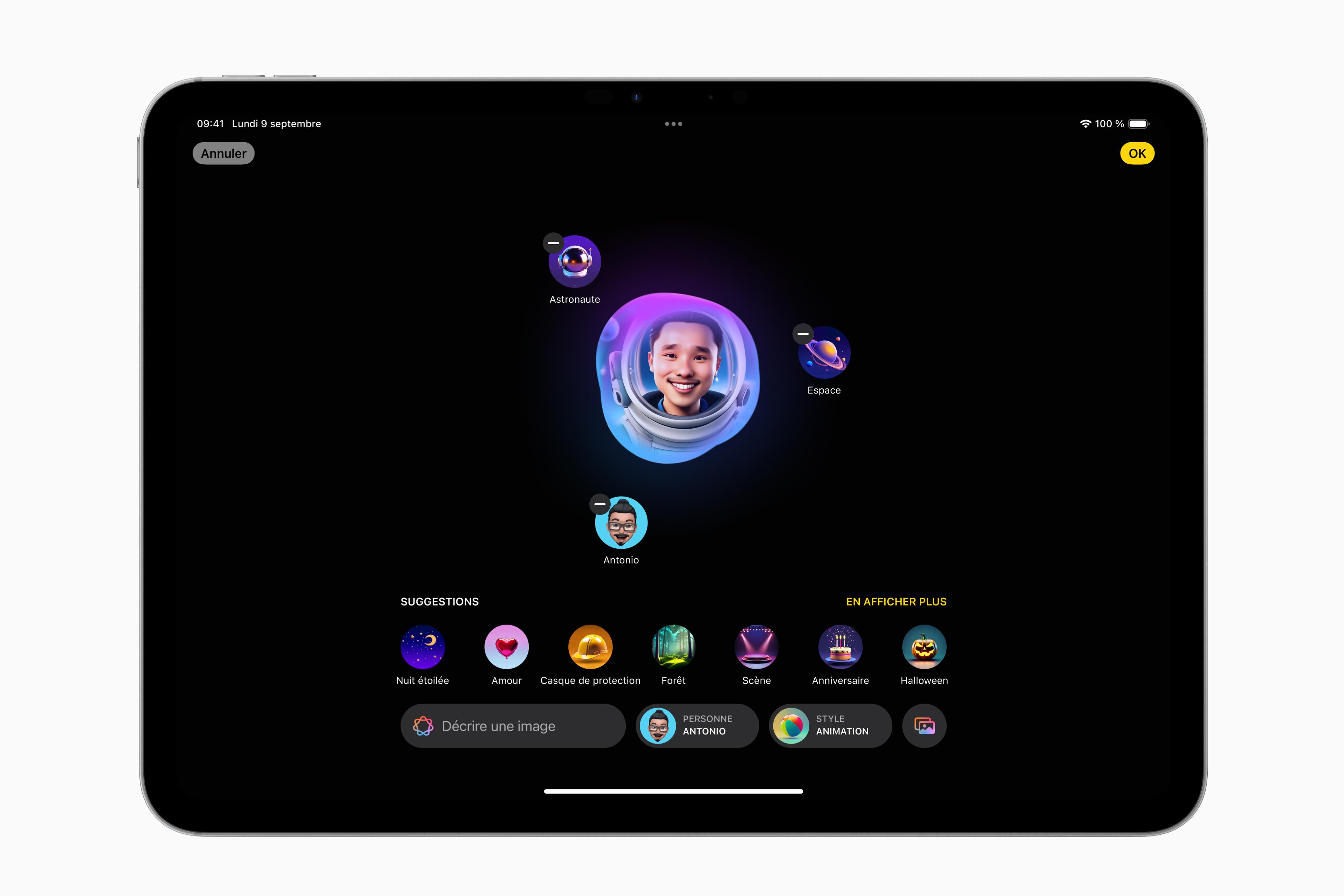Elle rêvait de Natalie Wood. En amputant son prénom d’un « h », elle est devenue chanteuse d’opéra. Mais son rêve d’être comédienne ne l’a jamais quittée. Peut-être s’est-il niché dans toutes les aventures qu’elle a menées après avoir fermé la porte du lyrique pour en ouvrir d’autres dans la chanson auprès de Michel Legrand ou du répertoire de Nougaro.
Aujourd’hui, pour boucler ses quinze années de complicité avec le pianiste Philippe Cassard, Natalie Dessay a décidé de jeter un pont vers les comédies musicales américaines dont elle conjugue les airs avec son ancrage dans l’école française du XIXe siècle. Ils en ont tiré un album intitulé Oiseaux de passage. La chanteuse, récompensée d’une Victoire d’honneur aux Victoires de la musique classique, fera ses adieux au genre lors d’un concert à l’Opéra Garnier dimanche prochain. Une vie s’arrêtera et une autre commencera, qui verra l’artiste souffler le 19 avril ses soixante bougies à la Philharmonie de Paris dans la fable musicale Gypsy.
Le JDD. Avec l’album Oiseaux de passage, vous clôturez un cycle avec le pianiste Philippe Cassard…
Nathalie Dessay. Il était venu me trouver quand j’ai décidé d’arrêter l’opéra. Je ne pensais pas refaire des récitals. C’est là qu’il m’a donné à entendre ses inédits de Debussy. Ensuite, on s’est lancés dans Schubert, Brahms, Mendelssohn, Clara et Robert Schumann… Ça ne s’est plus arrêté. À mon tour, j’ai voulu l’emmener sur mes terres avec ces mélodies françaises sur les oiseaux que je chéris tant. Louis Beydts (La Colombe poignardée), par exemple, il ne connaissait pas. Pourtant tous, de Chausson (Le Colibri) à Ravel (Trois Beaux Oiseaux du paradis) en passant par Poulenc (Reine des mouettes), leur ont consacré des airs. Au départ, on pensait se contenter d’un format vinyle. Mais rapidement, on s’est rendu compte qu’on ne pourrait tout faire rentrer dans seulement trente minutes de musique.
On trouve aussi beaucoup d’airs issus de comédies musicales américaines… Une manière de faire dialoguer la France et l’Amérique, comme du temps de Ravel ?
La suite après cette publicité
Non. À travers les mélodies sur les oiseaux, je voulais simplement rappeler ce qui m’a longtemps définie en tant que soprano léger. Les airs américains, que ce soit Stephen Sondheim dans Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet street, Samuel Barber quand il compose ses Mélodies passagères : puisque tout passe sur un poème de Rainer Maria Rilke ou bien encore l’opéra The Old Maid and the Thief composé par Gian Carlo Menotti pour la radio, c’était pour entrevoir mon futur. Le côté plus théâtral de la comédie musicale m’a toujours fait rêver, même si c’est toute une nouvelle technique de chant à appréhender.
Il faudra désapprendre à chanter ?
Pour Gypsy, que je présenterai à la Philharmonie, j’ai dû effectuer un travail énorme pour chercher les graves dans ma voix de poitrine et la porter vers le haut. J’ai dû apprendre à ne pas ouvrir la gorge pour la projeter car elle est microphonée.
Pourquoi vouliez-vous arrêter l’opéra quand vous formez ce duo en 2011 ?
J’avais tout simplement envie de reprendre ma vie en main. Trente années d’opéra m’avaient épuisée… Trop de pression, c’était devenu une souffrance. Et puis j’avais fait le tour de tous les rôles que je pouvais jouer. La Reine de la nuit, c’est deux airs et un ensemble : quand vous l’avez fait soixante-dix fois dans quatre ou cinq productions, vous avez compris.
« Moi, je suis hypersage, hyperdisciplinée, rien de rock’n’roll »
Mais, surtout, j’avais 48 ans. Pour une femme de cet âge, c’est difficile de jouer encore les Juliette. Il n’y avait plus de rôle pour moi. C’est le problème des sopranos légers : cette voix est associée à la jeunesse, tout comme celle de mezzo correspond aux méchantes ou aux filles qui se déguisent en garçon.
En 2001, vos cordes vocales vous ont lâchée…
Le jour où l’on m’a annoncé que je devais me faire opérer, j’ai cru que le monde allait s’écrouler. Puis on a appris que deux avions venaient de percuter les tours jumelles à New York. Alors, je me suis vite calmée. Au bout d’un quart d’heure, j’ai arrêté de pleurer comme une Madeleine. Je me suis ressaisie : j’étais vivante et en bonne santé. Si je ne devais plus chanter, il me faudrait l’accepter.
C’était une hypothèse que vous envisagiez ?
Oui, bien sûr. On ne sait jamais comment peut se dérouler une opération. Si le gars se loupe, c’en est terminé pour vous. Heureusement, ça n’a pas été le cas. Je n’ai jamais eu de réponse à cette question et, aujourd’hui encore, je ne l’ai pas.
En 2004, vous vous êtes à nouveau fait opérer. Votre collaboration avec Michel Legrand a-t-elle fait partie des nouvelles parties gratuites que vous vous êtes autorisé ?
Grâce à lui, j’ai compris ce qu’était la liberté. Michel Legrand s’en était emparé, s’échappant toujours des carcans où l’on aurait pu le cantonner. Quand on le croyait classique, il devenait chanson ; quand on le pensait chanson, il devenait jazz. Il m’a même composé un oratorio. Jusqu’à la fin de sa vie, il n’aura cessé d’explorer de nouveaux horizons. Je ne me remets pas de sa disparition en 2019 : il n’y a pas un jour où je ne pense à lui.
Quelle image de lui vous revient, là maintenant ?
Notre représentation des Parapluies de Cherbourg au théâtre du Châtelet en 2014. Je nous revois lorsque l’orchestre a entamé le thème principal de la comédie musicale. En l’entendant monter derrière nous, toute la troupe a eu les larmes aux yeux.
Est-ce votre aventure avec Michel Legrand qui vous a amenée vers Claude Nougaro, pour en avoir été l’un des compositeurs sur l’album Sur l’écran noir de mes nuits blanches ?
Dans Les Parapluies de Cherbourg, mon mari s’appelait Roland Cassard ; là, j’ai enregistré le disque avec le pianiste Yvan Cassar. Vous voyez, les Cassar me collent à la peau – avec ou sans « d » ! Nougaro, c’est une écriture que j’adore, ciselée, magnifique.
On peut se contenter d’en lire les textes, ça tient debout. Vous savez, moi, si ça raconte des conneries, je ne peux pas chanter ! Si j’ai choisi La Dame de Monte-Carlo (Poulenc) sur mon album Les Oiseaux de passage, c’est aussi parce que c’est un texte de Cocteau : l’histoire tragique et sublime d’une femme qui brûle la vie par les deux bouts. Hantée par la peur de vieillir, elle finit par se jeter dans la Méditerranée après une dernière partie au casino.
Est-ce que vous pourriez être cette femme ?
Non, c’est un personnage de composition ! Moi, je suis hypersage, hyperdisciplinée, rien de rock’n’roll : une vraie mamie qui boit son thé avec une goutte de lait face à la mer ! Chez moi, seul le travail compte. Mais c’est aussi parce que je me connais bien : je suis d’une nature addictive. Tout le monde me bassine avec les séries : si je m’y mets, je sais que je vais y passer ma vie. Alors, non, je n’ai pas vu Breaking Bad !
La vie est trop courte, en effet. Mais les journées n’en sont pas moins longues. C’est dur de vieillir ?
Je n’ai aucun problème à dire mon âge et je compte bien d’ailleurs le clamer haut et fort sur scène : le 19 avril, je fêterai mes 60 ans à la Philharmonie, où je jouerai dans Gypsy. Encore une comédie musicale ! Le public peut déjà s’attendre à ce que je lui fasse chanter un « joyeux anniversaire ! » et dans la langue de Poulenc, s’il vous plaît ! Je vais vous révéler un secret : vieillir présente bien des avantages.
« J’ai fait de la musique de haut niveau avec des gens merveilleux »
On ne cherche plus à se faire une place, on n’en est plus à vouloir prouver quoi que ce soit, si ce n’est à soi-même. Et puis, on se connaît mieux aussi. Vous voulez que je vous parle de la ménopause ?
Pardon ?
Oui, pourquoi pas ? L’actrice Naomi Watts en a bien fait un livre et je compte l’acheter ! C’est une étape importante dans la vie d’une femme et il faut savoir l’accepter. Je suis passée par là : il y a cinq ans, j’ai connu les bouffées de chaleur, toutes ces perturbations dans le corps. Votre silhouette change, mais votre visage aussi. Il n’y a plus qu’à s’adapter. Vous n’avez pas le choix. Quand j’avais 20 ans, je pensais encore y échapper : 60 ans, c’était être à l’article de la mort. Et pourtant, malgré les hécatombes et tous les amis que l’on commence à perdre autour de soi, on se dit qu’il y a encore de très belles choses à vivre.
Avez-vous l’impression, comme une actrice, d’être passée de rôle en rôle ?
Oui, même si ce n’est jamais aussi prégnant qu’au théâtre ou au cinéma. L’opéra maintient une certaine distance, la musique fait écran entre vous et le personnage. Mais oui, ça m’a amusée de jouer des filles complètement frivoles, des gamines écervelées ou romantiques. Ce que je ne suis pas du tout ! Je suis une sentimentale, pas une romantique. Le décorum, très peu pour moi !
Aimeriez-vous que l’on vous écrive un rôle au cinéma ?
Oui, mais pas de chanteuse ! Juste un personnage de femme normale de mon âge, voire pas normale du tout. Sans prétendre être Meryl Streep, c’est une expérience que j’adorerais vivre.
Mais Meryl Streep chante !
Et elle ne se fait pas doubler. Dans Florence Foster Jenkins de Stephen Frears, c’est elle qui donne de la voix. Dans ce film où elle joue une riche héritière rêvant de devenir cantatrice, elle parvient même à chanter faux avant de bien chanter. C’est extraordinaire !
D’autres rêves ? Vous faire écrire des chansons ?
J’adorerais que Maxime Le Forestier œuvre pour moi. Son album à la rose m’a accompagnée durant toute ma jeunesse. Mon frère, quelle chanson ! Comme Nougaro, j’adore tout chez lui, ses textes et ses musiques.
On est loin de l’opéra…
J’ai eu une vie avant. Les Bee Gees, Supertramp, Genesis ou The Cure avec leur chanson Boys Don’t Cry ont accompagné mon adolescence.
Le lyrique n’était donc pas une évidence…
Non, même si mes parents étaient mélomanes. Quand les premiers autoradios se sont popularisés dans les voitures, mon père s’est procuré l’intégrale de Beethoven et ma mère écoutait la Callas durant nos longs trajets. Habitant Bordeaux, nous allions souvent visiter les bords de mer. Parfois, on traversait la France pour aller en Savoie dans la famille de mon père. C’étaient les années 1970 : on avait notre petit pavillon de banlieue et notre caravane pour les vacances. Il nous est même arrivé de pousser jusqu’en Autriche. C’était l’époque des séjours linguistiques. Je me contentais de chanter des chansons de Jean Ferrat : son Aragon, je l’ai usé ! Dans ce registre, je le préfère à Ferré dont je trouve le vibrato trop serré. C’est comme Dylan, je n’arrive pas à l’écouter : il a une voix de canard, contrairement à Joan Baez dont nous avions étudié la chanson de rupture Diamonds and Rust en cours d’anglais.
Comment la route a-t-elle commencé pour vous ?
Je voyais bien que je chantais joliment. Un jour, alors que j’avais 17 ans, je me suis rendue à un cours de piano où je n’étais pas censée ouvrir la bouche. Ça s’est vite transformé en cours de chant. Là-dessus, je prends des cours de théâtre au Conservatoire de Bordeaux et, devant interpréter un personnage d’opéra, je me lance dans l’air de Pamina (La Flûte enchantée). Tout le monde était soufflé : « Tu dois faire du chant, c’est incroyable ! »
Et depuis, vous ne vous êtes plus retournée ?
Non, je ne regarde jamais en arrière. Pourtant, je me souviens bien être entrée à 21 ans dans les chœurs du Capitole. Je n’ai pas oublié non plus mes débuts dans Les Contes d’Hoffmann, ni mon entrée à l’Opéra de Paris. Puis, Vienne, Chicago, San Francisco, Barcelone, Madrid, le Covent Garden… J’ai fait de la musique au plus haut niveau, j’ai rencontré des gens merveilleux et joué avec les plus beaux orchestres dans les plus belles salles du monde et avec des metteurs en scène superbes. Je n’ai pas oublié car ça a été une belle vie. Je ne réécoute pas non plus mes disques : je cherche toujours à regarder devant moi pour trouver une nouvelle part de beauté. Même dans les chants les plus désespérés, je sais qu’elle existe. C’est ma place dans la société : faire rêver. Quand je chante I Want Magic d’André Previn, c’est ce que je recherche. Je guette toujours cet instant.
Oiseaux de passage ★★★, de Nathalie Dessay & Philippe Cassard (La Dolce Volta). En concert le 30 mars à l’Opéra Garnier et le 19 avril à la Philharmonie de Paris.
Source : Lire Plus